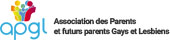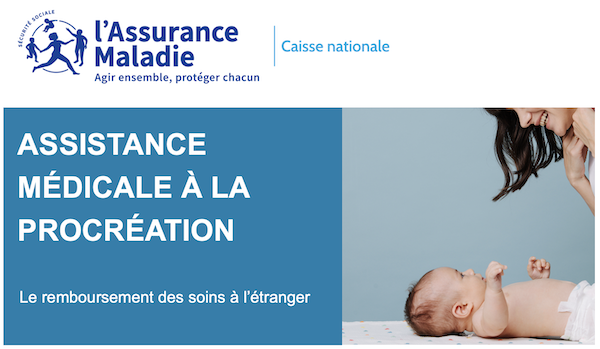IAD
L'accès à la PMA pour toutes les femmes aujourd'hui
Jusqu’au 3 août 2021, l'État français apportait son aide exclusivement aux couples hétérosexuels concernés par des problèmes d’infertilité grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP = PMA). Les femmes célibataires étaient aussi exclues bien que la loi permette aux personnes célibataires d’adopter. Lors de l’adoption du Mariage pour Tous, l’APGL avait incité les responsables politiques à discuter sur l’accès de toutes les femmes à la PMA. Elle demandait que cette réforme voit le jour dans le cadre d’une loi famille avant la fin de 2013, tel qu’il était initialement prévu dans la feuille de route du Gouvernement Hollande.
Malheureusement, il fallut attendre encore 8 ans.
La loi a changé le 4 août 2021 avec l’adoption de la révision de la Loi de Bioéthique. Les techniques d’AMP sont maintenant ouvertes aux couples de femmes et femmes non mariées.
De nombreux pays avaient déjà renoncé à ces critères strictement médicaux, ce qui avait permis à de nombreuses Françaises célibataires ou en couple de réaliser leur projet d’enfant en dehors du territoire national (Belgique, Espagne, Pays-Bas...). Ces mêmes femmes sont suivies par des personnels de santé français remarquables par leur dévouement et sans que ces derniers ne portent de jugement sur l’homosexualité de ces personnes.
L’APGL se réjouit que cette réforme du code de la santé publique soit enfin devenue une réalité, permettant aux femmes homosexuelles de bâtir leur projet parental dans leur pays.
Il reste néanmoins des droits à affermir pour l’accès des personnes trans aux techniques d’AMP, pour une filiation à l’égal des couples hétérosexuels, pour avoir accès à des techniques de réception des ovocytes de la partenaire (ROPA) et pour de meilleures conditions de prise en charge en France (augmenter le nombre de centres de prise en charge, réduire les délais, améliorer l’accueil…).
L’APGL participe aux comités organisés par l’Agence de Biomédecine pour le suivi de la mise en place de la Loi de Bioéthique et œuvre toujours pour les droits des familles LGBT. L’APGL siège aussi à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD).
Pour en savoir plus sur la PMA en France depuis 2021 : cliquez ici.
Pour connaître les démarches de filiation pour les coupels de femmes : cliquez ici.
Plus d'infos pour les adhérent·es sur l'intranet : cliquer ici.
Si vous souhaitez nous contacter pour plus d’information, cliquez ici.
PMA en France : ce qui change (ou pas) le 31 mars 2025
Le 31 mars 2025 marque la fin d'une période transitoire ouverte par la loi de bioéthique d'août 2021. Toutes les tentatives d'insémination artificielle avec don de gamètes et toutes les nouvelles fécondations in vitro seront réalisées avec des gamètes de donneur·ses ayant consenti à l'accès aux origines pour les enfants devenus adultes issus de leurs dons.
PMA : que faire en cas de refus de prise en charge en France ?
Votre prise en charge dans un parcours d'assistance médicale à la procréation en France est soumise à conditions. On fait le point.
Qu'est-ce qu'on entend par PMA ?
La PMA (Procréation Médicalement Assistée ou son équivalent AMP pour Assistance Médicale à la Procréation) est le terme le plus couramment utilisé pour décrire les méthodes par lesquelles les femmes conçoivent leurs enfants lorsqu’elles ont recours à une aide médicalisée et/ou une tierce personne qui donne ses spermatozoïdes.
Le remboursement de soins d'AMP à l'étranger
Le fait de recourir à des soins d'assistance médicale à la procréation dans un autre pays de l'Union Européenne ou en Suisse peut donner droit à un remboursement de frais. Sous conditions. On fait le point.
PMA en France : l'accès aux origines pour les personnes conçues avec don de gamètes
La loi de bioéthique promulguée en août 2021 a engagé une réforme importante : la possibilité de l'accès aux origines pour les personnes issus d’un don de gamètes en France, une fois majeures.